NAPALM DEATH
Math Appeal Madness (2016 & 2018) J’ai 18 ans et je fais des maths dix-huit heures par jour. Je dérive du soir au matin, je passe mes nuits à diagonaliser, développer, résoudre (un peu), sécher (souvent). J’interpole, triangularise, j’intègre et surtout je me désintègre. C’est 1991, dans une piaule minuscule d’internat du 16e arrondissement. C’est 1992, 1993, 1994, c’est le début des années quatre-vingt-dix qui passe sans crier gare et je suis déjà mort.
J’ai 18 ans et je fais des maths dix-huit heures par jour. Je dérive du soir au matin, je passe mes nuits à diagonaliser, développer, résoudre (un peu), sécher (souvent). J’interpole, triangularise, j’intègre et surtout je me désintègre. C’est 1991, dans une piaule minuscule d’internat du 16e arrondissement. C’est 1992, 1993, 1994, c’est le début des années quatre-vingt-dix qui passe sans crier gare et je suis déjà mort.
C’est sans doute pour ça que le poster de Napalm Death n’a jamais quitté le mur au-dessus de mon lit. La faucheuse, son sourire troué et trois personnages sans visage au-dessus d’une tombe. Life ?, y lit-on et souvent j’y réfléchis. Souvent je me demande quand je parviendrai à effacer le point d’interrogation.
Je n’en parle pas avec David. Bien qu’on partage nos 9 m2 toutes ces années, on ne parle pas trop avec David. Quand on ne bûche pas ensemble sur une khôlle de maths — ou de physique ou de chimie —, quand on ne boit pas des bières achetées par palettes au Leader Price pour oublier ce qu’on a bachoté la veille, on passe notre temps à écouter fort de la musique. Très fort. Entombed, Loudblast, Pestilence, les premiers Sepultura, les premiers Metallica et plein d’autres groupes en A. Peu importe en vérité. Seul compte que les guitares soient bien bien fortes et que les murs en papier mâché de notre chambre tremblent.
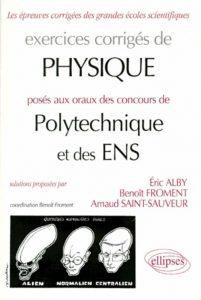 Et puis une fois par trimestre, c’est permission. On quitte notre prison en plein quartier friqué pour l’Arapaho, le Gibus ou d’autres lieux dont j’ai aujourd’hui oublié le nom. Mais je n’ai pas oublié les concerts. Je n’ai pas oublié Carcass, Morbid Angel, Slayer, Pantera. Et je n’ai pas oublié non plus que nous n’avons jamais vu Napalm Death avec David. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment on a pu passer à côté de Suffer the Children ou Scum en live, alors que c’étaient nos hymnes — au réveil ou après un concours blanc désastreux ou simplement quand on voulait faire chier nos voisins de chambrée.
Et puis une fois par trimestre, c’est permission. On quitte notre prison en plein quartier friqué pour l’Arapaho, le Gibus ou d’autres lieux dont j’ai aujourd’hui oublié le nom. Mais je n’ai pas oublié les concerts. Je n’ai pas oublié Carcass, Morbid Angel, Slayer, Pantera. Et je n’ai pas oublié non plus que nous n’avons jamais vu Napalm Death avec David. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment on a pu passer à côté de Suffer the Children ou Scum en live, alors que c’étaient nos hymnes — au réveil ou après un concours blanc désastreux ou simplement quand on voulait faire chier nos voisins de chambrée.
Alors bien sûr, vingt-cinq ans plus tard, cela nous rend tout chose. David a fait le voyage depuis Londres, c’est son premier Hellfest et je suis heureux qu’il soit là à côté de moi. Je ne lui dis pas — on ne parle toujours pas trop —, mais je passe un bras sur son épaule quand Mark Barney débarque avec son éternel Bermuda sur scène — et je ferai pareil deux ans plus tard, au même endroit, à peu près à la même date. Je passe mon bras sur l’épaule de mon pote, j’imagine que comme moi il essuie une larme. Puis je le balance dans le premier pogo.
 Même si on en revient vite — on a plus dix-huit ans et nos cervicales sont pas mal amochées — on goûte la suite un sourire constant aux lèvres. Du plus vieux — Mentally Murdered, You Suffer— au plus récent — Apex Predator, When All Is Said and Done—, tout est parfait, tout est si clair, si précis. Et puis surtout il y a ce truc étonnant, cette gageure avec une musique que ma mère qualifiait de magma infâme. Le show s’enchaîne avec évidence, notamment grâce à la flamboyance de Mark « Barney » Greenway, son growl inimitable et sa faconde entre les morceaux. Il nous raconte une histoire et on y est.
Même si on en revient vite — on a plus dix-huit ans et nos cervicales sont pas mal amochées — on goûte la suite un sourire constant aux lèvres. Du plus vieux — Mentally Murdered, You Suffer— au plus récent — Apex Predator, When All Is Said and Done—, tout est parfait, tout est si clair, si précis. Et puis surtout il y a ce truc étonnant, cette gageure avec une musique que ma mère qualifiait de magma infâme. Le show s’enchaîne avec évidence, notamment grâce à la flamboyance de Mark « Barney » Greenway, son growl inimitable et sa faconde entre les morceaux. Il nous raconte une histoire et on y est.
On est à Clisson ces soirs-là, mais on est aussi à Birmingham, on est au Mermaid en 1985 pour leurs premiers concerts, on est dans les studios de la BBC pour leurs Peel Sessions. Et puis on est aussi dans notre piaule de 9 m2 à Janson de Sailly. On est là-haut sous les toits avec ces Anglais à la classe internationale et cette fois il n’y a pas de doute.
Cette fois, on est bien vivants, David.